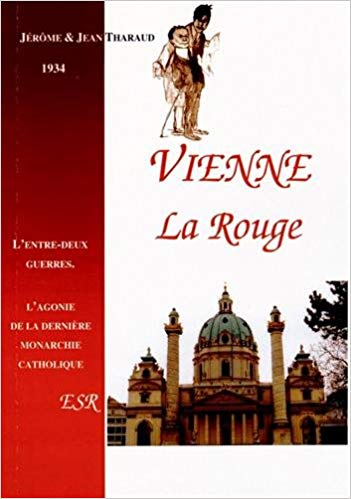
Comme tous mes confrères, j’écrivis à mon journal les bruits qui circulaient à Vienne, ajoutant que personne à cette heure n’était aussi discrédité dans le monde ouvrier que MM. Bauer et Deutsch. Je faisais en passant la remarque que Béla Kun et les dix-neuf Commissaires bolchévistes du peuple n’avaient pas agi plus bravement lorsqu’ils avaient senti en Hongrie[, en 1919,] les choses commençaient à se gâter. Cela me valut, dans le Populaire, cette apostrophe de M. Léon Blum : « On me signale […] une correspondance expédiée de Vienne par les frères Tharaud et que leur vaudra vraiment la palme dans le concours d’ignominie. […] »
Que Léon Blum veuille bien m’excuser. […] C’est entendu, Otto Bauer n’a quitté Vienne que mardi ; Julius Deutsch, lui, a tenu vingt-quatre heures de plus. Mais l’un et l’autre sont partis, laissant leurs troupes se débrouiller, comme elles pourraient avec l’armée, la police et la Heimwehr. Quand Léon Blum écrit : « Lorsque le socialisme a lutté, comme l’ont fait à Vienne les admirables combattants groupés jusqu’à la dernière heure autour de Julius Deutsch et d’Otto Bauer », qui se trompe, lui ou moi ? Otto Bauer qui fuyait dès le mardi, c’est-à-dire en pleine bataille, et Julius Deutsch qui abandonnait mercredi soir et un combat qui n’a pris fin que le jeudi à midi, ont-ils combattu jusqu’à la dernière heure ? On pourrait le soutenir pour Julius Deutsch, car le combat du jeudi matin n’était, pour ainsi dire, qu’un combat d’arrière-garde, mais pour le docteur Otto Bauer ? …
Je sais bien que leur cas était sinistre. Tomber aux mains de l’adversaire, c’était la cour martiale et la certitude d’être pendu deux heures après le jugement. Et ce n’est pas beau d’être pendu, [.] Je sais qu’on ne peut sans pharisaïsme demander à personne de se conduire en héros. La politique se fait à la mesure de la commune humanité. Mais quand on n’est pas décidé à courir certains risques, on ne répète pas complaisamment, pour se faire applaudir par des auditoires enthousiastes, que la Social-démocratie ne saurait être sauvée que s’il y avait des gens décidés à sacrifier leur vie pour elle. […]
Pour avoir pris au sérieux ces paroles, plus de deux cents travailleurs ont perdu la vie en combattant ; plusieurs centaines furent blessés ; sept ou huit ont comparu devant les cours martiales et ont subi le destin que Bauer redoutait pour lui-même : un grand nombre sont sous les verrous et dans les camps de concentration. Mais le sacrifice de vos amis, Léon Blum, où est-il ? … Ces grands doctrinaires socialistes, ces abondants orateurs, ces casuistes subtils ne tiennent décidément pas le coup dans l’action. Il faut voir les choses comme elles sont : dans l’émeute de Vienne, tous les grands chefs socialistes ont abandonné leurs troupes, soit qu’ils se soient laissé paisiblement arrêter dans leur logis (et trop heureux de l’être !), soit qu’ils se soient arrangés pour lâcher le combat au bon moment. […]
Otto Bauer nous dit avec ingénuité qu’il n’y avait pour lui que alternatives : être arrêté ou fuir. N’y avait-il pas une troisième, qu’il n’a même pas envisagée : prendre un fusil et partager le sort des prolétaires, dont il était le chef, quoi qu’il pût en arriver ? En son âme et conscience, il a estimé qu’il rendait un plus grand service à son parti en quittant la bataille, pour chercher un refuge en Tchéco-Slovaquie, qu’en se laissant abattre par la balle d’un paysan heimwehrien ou d’un policier de Dollfuss, ou encore qu’en se laissant pendre. Peut-être est-ce une erreur. Sans décrocher la palme dans le grand concours d’ignominie, il est permis de croire, Léon Blum, qu’il y a de telles circonstances où une fin courageuse est mille fois plus utile à un parti que tous les articles, toutes les brochures, tous les livres et tous les discours du monde.
Jérôme & Jean Tharaud, Vienne la rouge, p. 226-232